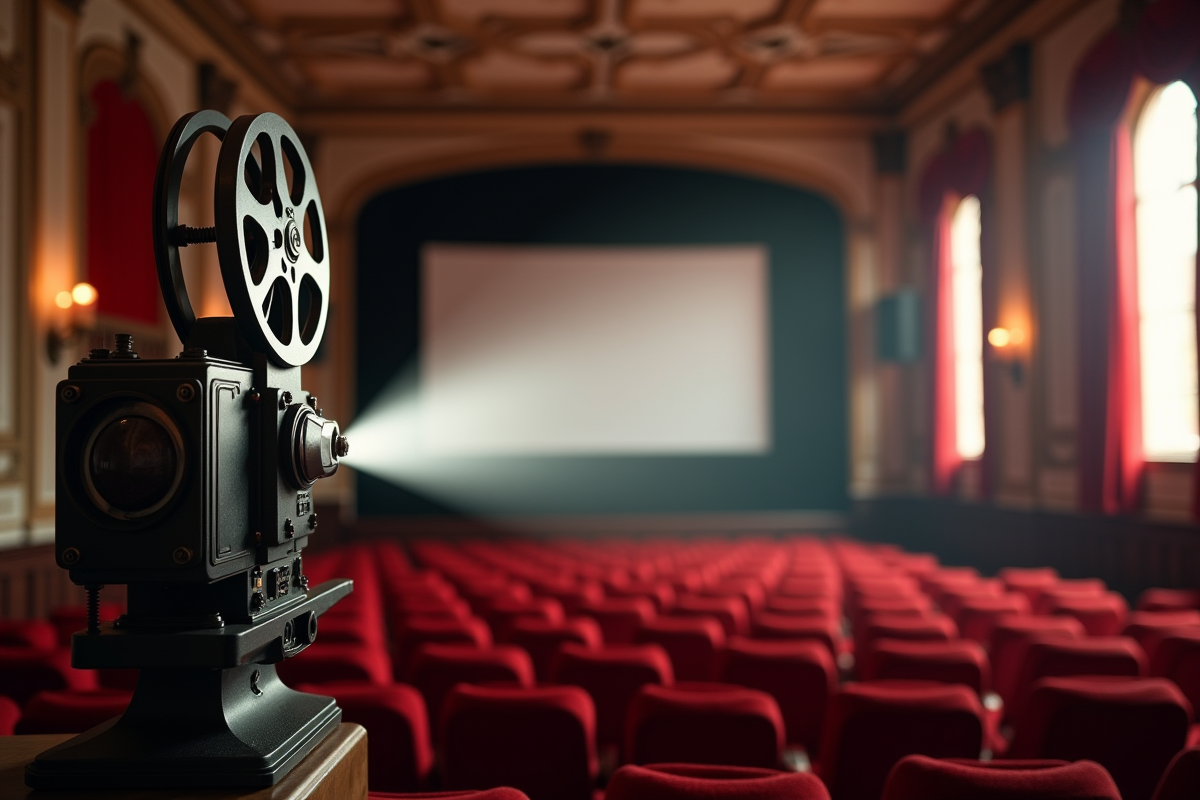En 1911, Ricciotto Canudo propose d’ajouter le cinéma à la liste des arts majeurs, bouleversant la hiérarchie établie par l’Académie des Beaux-Arts. Contrairement à la peinture ou à la sculpture, le cinéma naît d’une invention technologique avant d’être reconnu comme discipline artistique.Dès ses débuts, il échappe aux frontières rigides : ni pur divertissement, ni simple technique, il suscite débats et controverses dans les milieux culturels et intellectuels.
Le septième art : une place singulière dans la famille des arts
L’expression septième art s’impose à la faveur d’un coup de force intellectuel : Ricciotto Canudo, critique italien, défend en 1911 l’idée que le cinéma mérite d’être adossé aux six arts majeurs de l’époque, architecture, sculpture, peinture, musique, poésie et arts de la scène. Là où l’Académie campe sur ses positions, Canudo brise le cercle. Inspiré par Hegel et tout un courant de réflexion sur l’esthétique, il affirme que le cinéma n’est pas seulement le dernier-né, mais qu’il dépasse et réunit les autres disciplines : un art total, capable de synthétiser image, mouvement, son et récit.
Le cinéma s’impose justement par sa faculté à marier les arts visuels et les arts temporels. Cadrage, montage, musique, dialogues : tout s’imbrique, tout se répond. L’image en mouvement dialogue avec la structure du temps, propre à la musique et aux arts de la scène, tandis que l’espace reste celui de la peinture, la sculpture ou l’architecture. Difficile, dès lors, de réduire le cinéma à une simple prouesse technique ou à un divertissement industriel.
Ce qui frappe, c’est la porosité nouvelle entre les disciplines. Selon les travaux des Presses universitaires de France, cette hybridation donne naissance à un médium inédit : le cinéma absorbe, réinvente, métamorphose les langages de l’image et du récit. Pour Canudo, le septième art ouvre la voie à une forme d’utopie esthétique où chaque film devient une œuvre collective et polyphonique, tendue entre espace, temps et sens.
Pourquoi le cinéma a-t-il été reconnu comme un art à part entière ?
Accéder au rang d’art, pour le cinéma, n’a rien d’évident. Longtemps, il reste associé au forain, au gadget technique, au pur loisir. Mais au début du XXe siècle, des penseurs comme Ricciotto Canudo vont au front : ils affirment que l’œil de la caméra est porteur d’une vision, qu’il transforme le réel et propose une expérience singulière. Le cinéma, selon eux, ne se contente plus de reproduire le monde : il l’interprète et l’invente.
La force du cinéma vient de sa capacité à articuler image et narration. Chaque plan, chaque lumière, chaque durée, chaque découpage porte la trace d’un choix, d’une intention. Dans les années 1920, des créateurs se saisissent de ce nouveau langage pour repousser les limites du médium. Le concept de cinéma d’auteur s’impose : des critiques et théoriciens français défendent l’idée que certains films relèvent d’une démarche artistique individuelle, proche de celle d’un écrivain ou d’un peintre.
Le cinéma français joue un rôle de pionnier. Des personnalités telles que Jean-Yves Chateau ou Ricciotto Canudo interrogent la place de l’auteur cinéma, tandis que la critique s’attache à valoriser la diversité des styles, de l’expérimental à la grande fresque populaire. Aujourd’hui, le cinéma art s’appuie sur cet héritage : l’émergence de festivals, la reconnaissance institutionnelle, sa capacité à influencer la culture, tout cela consacre le septième art comme un champ d’invention, de liberté et de mémoire collective.
Des origines à nos jours : comment l’histoire du cinéma façonne sa définition
Le cinéma naît dans la surprise et l’étonnement. En 1895, les frères Lumière projettent à Paris leurs premières images animées : l’assemblée découvre, sidérée, la réalité transfigurée par le mouvement. L’invention technique se mue, très vite, en langage artistique. Les premiers films ne se contentent plus de capturer le réel : ils s’aventurent dans la fiction, le montage, l’invention de mondes imaginaires. De Georges Méliès à D.W. Griffith, le cinéma devient à la fois miroir de la société et outil de construction de nouveaux récits.
L’arrivée du son dans les années 1920, puis la généralisation de la couleur, bouleversent totalement la pratique et l’expérience du cinéma. Avec chaque rupture technologique, la définition du septième art évolue. Aujourd’hui, le cinéma numérique redistribue les cartes : production, diffusion, réception, jusqu’à la conception même d’œuvre cinématographique, rien n’est figé, tout bouge.
Voici quelques repères qui balisent l’évolution du cinéma au fil des décennies :
- Depuis les premières prises de vues jusqu’aux récits les plus élaborés, l’histoire du septième art épouse les bouleversements techniques et créatifs.
- La notion de figure d’auteur s’impose, oscillant entre la vision individuelle et la collaboration propre aux métiers du film.
- Les territoires s’entremêlent entre cinéma, télévision, radio et bande dessinée, brouillant toujours plus les frontières.
De Jean-Luc Godard à l’époque contemporaine, chaque génération s’empare de la caméra pour questionner le réel, la fiction, la technique. L’histoire du cinéma avance par à-coups, suivant les tensions sociales, les révolutions artistiques, les avancées technologiques. Le septième art reste un terrain fertile pour l’expérimentation, fidèle à la conviction que tout film n’est qu’une tentative, inlassable, de saisir la volonté de représentation chère à Schopenhauer.
Le cinéma, miroir et moteur de la société contemporaine
Réduire le cinéma à une simple narration ou à une succession d’images serait passer à côté de sa vraie puissance. Ce médium agit à l’échelle mondiale comme un miroir de nos sociétés, mais aussi comme un moteur qui façonne les mentalités et accélère les transformations. Les films captent tensions, espoirs, peurs collectives. Mais ils génèrent aussi des débats, influencent des comportements, bousculent les habitudes. Le cinéma populaire nourrit des imaginaires communs, tandis que le cinéma d’auteur pose les questions qui dérangent et décortique les récits dominants.
Ce n’est pas un hasard si le soft power du cinéma s’est imposé si fortement : Hollywood, Bollywood, mais aussi l’audace du cinéma français ou la montée du cinéma sud-coréen en témoignent. La force d’attraction du film tient à sa souplesse : il peut se faire arme de critique sociale, outil d’exploration politique, laboratoire esthétique. Il traverse toutes les couches sociales, toutes les générations, tous les continents.
On peut distinguer, à grands traits, deux grandes dynamiques qui structurent le paysage du cinéma actuel :
- Le cinéma d’auteur, incarné notamment par Jean-Luc Godard, François Truffaut ou Jean Epstein, vise une ambition esthétique ou politique, parfois même un idéal de société.
- Le cinéma populaire rassemble les foules, fédère des publics très différents, tout en intégrant les enjeux de notre temps.
Des penseurs comme Jacques Rancière ou Raymond Bellour l’ont montré : le cinéma bouleverse les repères du système des arts et redistribue la place de l’art dans la culture. Il ne se laisse pas enfermer dans une case : ni tout à fait spectacle, ni tout à fait littérature, il devient un carrefour où circulent les sensibilités et les idées de notre époque. Sa force, c’est bien cette capacité à créer du collectif, à susciter le dialogue, à transformer, film après film, notre façon d’habiter le monde.